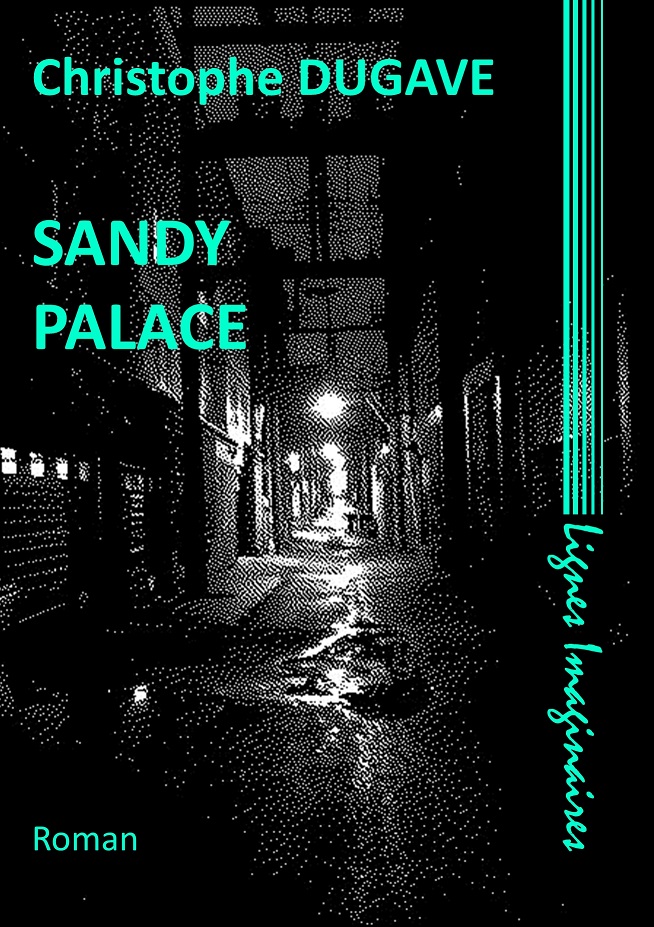Présentations
Sandy palace : l’incroyable mais réaliste dégringolade d’une adolescente trop sage
"Sandy Palace" retrace le parcours de Sandrine, une adolescente de 16 ans, depuis la privilégiée vallée de Chevreuse aux trottoirs du Vancouver Downtown Eastside, le quartier le plus miséreux du Canada. Entre les deux, un gouffre que Sandrine va franchir brutalement et involontairement. L’élément déclencheur : la trahison de sa mère (trop) idolâtrée et la peur du futur que provoque cette révélation. Une seule solution : la fuite. Mais la petite fugue devenue grand voyage va bien vite tourner au cauchemar.
"Sandy Palace" explore les thèmes chers à l’auteur : "l’instant où tout bascule", le problème du choix et du destin, l’irrémédiable enchaînement du pire. La première perfidie n’est pas celle que l’on croit et, comme tout au long du roman, il décrit et décortique les effets imprévisibles d’un évènement anodin. Tout commence avec la victoire historique des Bleus en juillet 98. Il y a la fête, la flûte de champagne bue tard en soirée, le réveil difficile la tête dans du coton, le stage d’équitation qui commence mal et le retour inopiné à la maison, la discussion téléphonique interceptée au coin d’un couloir et soudain la révélation. Le choc. L’impression d’être passée à travers un mur de briques (…J’en avais un comme ça chez moi. Enfin, sans le savoir. Il est apparu brutalement un jour, en travers de mon chemin et je suis passée à travers…). Et puis le simulacre de fugue, d’abord appel au secours puis petite vengeance qui, par dépit, devient réel envol pour une incroyable et dramatique aventure.
Le thème de l’adolescent(e) qui fugue et tombe dans la drogue n’est certes pas nouveau. Les plus belles pages produites sur ce sujet sont souvent issues de documents écrits par les protagonistes (la série des "Moi Christiane F., …" de Christiane Felscherinow), "Dans ma peau – Mémoires d’une prostituée" (Kate Holden), ou rédigés sous forme de journal intime souvent factice mais néanmoins plausible ("L’herbe bleue" de Béatrice Sparks). Dans la plupart des cas, le mal prend racines dans une enfance toxique ou bouleversée ("Le soleil au bout de la nuit" de Nicole Castioni ou "Junk" de Melvin Burgess), un deuil ou une séparation ("Un endroit où se cacher" de Joyce Carol Oats), la mauvaise influence d’un parent, d’un ami ou d’un groupe, voire le simple mal être ambiant ("Bleu presque transparent" de Ryû Murakami). Rares cependant sont les récits dont le héros est une jeune fille sage et sans problèmes mais trop naïve et trop exigeante.
Dans "Sandy Palace", le suspens repose moins sur les péripéties, souvent prévisibles parce qu’implacablement logiques et inévitables, que sur l’enchainement machiavélique des circonstances qui mènent d’une simple histoire familiale à une tragédie personnelle à la résonnance très médiatique. L’autre originalité du roman découle de l’utilisation de deux évènements tout à fait réels, la coupe du monde de football en 1998, en ouverture du roman, et l’affaire Pickton qui secoua la province de Colombie Britannique et le Canada tout entier au début des années 2000 pour conclure cette histoire déchirante. Le premier sert juste de déclencheur tandis que le second recoupe l’intrigue, justifiant le titre de l’ouvrage, conférant une authenticité certaine à cette histoire rocambolesque mais néanmoins en partie réelle. En préambule, l’auteur annonce très clairement la thématique explorée au-delà de l’histoire, inspirée par le parallèle établi entre un incident (personnel) réel qu’(il) raconte parfois avec une pointe de culpabilité dans la voix et une désagréable sensation dans le ventre, et l’histoire tragique de Sandrine. Le résultat : une histoire bouleversante, attachante voire même addictive.
L’effet de contraste et d’opposition, largement exploité tout au long du roman, saisit le lecteur : discussion insouciante de Sandrine et Cécile alors même que commence la finale du Mundial, profond désarroi de Sandrine en totale dissonance avec le climat estival et festif, coup de tête excessif qui transforme une histoire de famille et affaire d’état et un simulacre de fugue en une fuite éperdue, contraste incroyable entre la situation privilégiée de Sandrine en France et sa destinée outre-Atlantique… Les personnages principaux, complexes et ambivalents, se révèlent également sous deux personnalités bien différentes selon les circonstances : Sandrine sage/Sandy rebelle, Marion fragile/Skipper impitoyable, Jordan étudiant candide/ marginal pervers, Sarah amie solide/ droguée influençable, Lucy compagne protectrice/partenaire égoïste.
En opposition totale avec le ton utilisé dans la suite de l’histoire, au point que l’on pourrait s’imaginer avoir ouvert une romance pour ado, le premier chapitre nous délivre déjà une avalanche d’informations : Sandrine l’inquiète, digne de confiance, très complice avec cette grande sœur qui lui ressemble physiquement mais paraît pourtant moins mature, mais aussi Sandrine :’adoratrice de l’icône matriarcale qui va la décevoir malgré leur complicité et leur adoration mutuelle. Mais le récit prend rapidement un ton plus grave, volontairement perturbant. Et si sombre n’est pas désespéré, le récit très noir met bien en exergue l’acharnement du destin, la petite flamme de l’espoir toujours renaissante et inlassablement soufflée par la malchance (ou la chance trop insolente). Sans verser dans le pathos, l’auteur explore minutieusement les mécanismes intimes qui conduisent une adolescente en apparences raisonnable mais encore malgré tout immature, à s’embarquer pour un voyage sans retour. Rien, dans le traitement ni le style, n’épargne le lecteur : le quotidien sordide, la réalité crue et sans concessions, la complexité inextricables des sentiments, toile d’araignée dans laquelle se débat l’héroïne. On attendra en vain que l’auteur fasse preuve de clémence dans ce récit glaçant mais profondément humain.
Le lecteur sortira peut-être brisé de cette découverte passionnante mais éprouvante, et sans nul doute scandalisé par les informations réelles livrées en épilogue et par les réalités de l’affaire Pickton que dénonce l’auteur. Et l’on portera immanquablement le deuil de Sandrine, la jeune héroïne devenue au fil des pages amie, fille ou petite sœur.
QUELQUES LIGNES EXTRAITES DE "SANDY PALACE" :
Dans la file d’attente, au milieu des vacanciers en partance, tassée entre les piles de bagages qui débordaient des chariots, Sandrine s’accrocha à la certitude que sa supercherie ne passerait pas le comptoir d’enregistrement, que l’hôtesse détecterait la fugueuse dans cette fille au regard perdu tenant mollement un unique petit sac au bout de son bras. Pourtant la femme ne s’étonna guère qu’elle n’enregistrât aucun bagage en soute et lui remit sans sourciller une carte d’embarquement et un bon pour un repas gratuit dans un restaurant de CDG I, pour s’excuser du retard, dit-elle. Vaguement nauséeuse, Sandrine ne profita pas du déjeuner, préférant scruter le flux des arrivants et guetter l’appel de son nom jusqu’à l’heure du départ. Elle souhaitait bien plus qu’elle ne craignait l’irruption des policiers alertés, lancés à sa poursuite. Mais il n’y avait personne pour la saisir ni même la recueillir. Juste une main qui lui avait tendu un billet par-dessus un comptoir. Car soudain, cette fuite ubuesque prenait une réalité : le petit rectangle en carton vernissé, le sésame décoré de son bordereau magnétique. Sandrine commença d’avoir peur, vraiment, comme un kayakiste embarqué sur un rapide à la puissance sous-estimée, entrainé par le courant, incapable de s’arracher au cours des événements initiés, provoqués, à l’échéance improbable et redoutée. Elle aurait voulu tout arrêter, lever le pouce en signe de renoncement, se retrouver dans son lit, les farces les plus courtes sont les meilleures, Cécile tu es furieuse, je comprends, désolée, mais tu ne sais pas tout...
Mais où était Cécile ? Retournant sa chambre, lancée au domicile de Célia à la recherche de cette sœur traîtresse, déjà en route pour Roissy ou bien au commissariat de police ? Sandrine se sentit soudain honteuse, plus coupable que cette mère qui les délaissait pour un autre et qu’elle ne parvenait pas à haïr tout à fait. Elle, Sandrine, jouait sciemment avec le bonheur des autres, pour faire mal. Qu’avait-elle donc fait là ?
Quand elle se présenta au contrôle de sécurité, Sandrine comprit que, malgré ses cheveux plus longs et la légère différence de stature, elle ferait illusion et que le policier n’arrêterait pas sa course. Elle ne cherchait pas à passer inaperçue, ne tentait pas de se dérober aux regards inquisiteurs des fonctionnaires. La meilleure façon de se cacher était de se montrer. Soudain, elle souhaita réussir, comme pour se punir d’être allée trop loin. Point de non-retour. Elle n’avait plus envie que Cécile déboule, la dénonce, qu’on l’attrape, qu’on la livre à ses parents, encadrée par deux policiers de l’air et des frontières. Ce voyage n’était rien d’autre que le prolongement de ce geste, quand elle s’était emparée des billets et du passeport. Tout s’était décidé avant, alors qu’elle se tenait sur le seuil de la chambre. Le reste suivait la logique des cartes de géographie. La vraie frontière, elle l’avait franchie à la maison.
© Lignes Imaginaires 2017/C. Dugave 2009
"Cam@rdage" : Chasse au tueur dans les arcanes d’internet
Lignes Imaginaires a réédité "Cam@rdage", premier roman de Christophe Dugave, en format poche. Lors de sa première publication par les Editions du tremplin, ce thriller avait obtenu plus qu’un succès d’estime même si un critique spécialisé l’avait qualifiée de "Thriller light", sans doute parce qu’il évitait une avalanche de détails techniques relatifs à Internet, peut-être aussi parce que la couverture originale suggérait davantage de gore, promesse non tenue dans le récit. Car mis à part quelques rares scènes sanglantes, l’auteur ne se complaît pas dans les bains d’hémoglobine et la sexualité explicite et préfère le suspense psychologique à la violence pathologique. S‘y ajoute le drame personnel et la quête désespérée de l’héroïne, sans oublier l’hiver québécois "de poudreries en white-out, de soirs de slush en matins de glace", à la poétique très hivernale heureusement réchauffée par les savoureuses expressions de nos cousins d’Amérique.
Cam@rdage, assemblage incongru de la mort (la Camarde) et de "Bavardage" (l’ancien chat de Yahoo) dont le sens commun (méconnu) est annoncé dès les pages de garde, se sert en effet du chat comme d’un terrain de jeu pour explorer la complexité des âmes. Ne vous attendez donc pas à affronter des notions compliquées d’informatique ou un vocabulaire abscons : la technologie du Web n’y est que brièvement évoquée. Ce thriller se démarque donc de "Hell.com" (Patrick Senécal), "Web Mortem" (Christine Adamo), "la mort vous a choisi" (Eric Laurent) et se rapproche davantage de romans comme "Ecran noir" (Pekka Hiltunen), "Necroprocesseurs" (Jacques Vettier) ou "Chain Mail" (Hiroshi Ishizaki).
Raconté à la première personne, assaisonné de joual (dialecte québécois), le récit immerge totalement le lecteur et met en scène des personnages complexes et denses, à commencer par l’héroïne. Anne est en effet déchirée entre ses études, sa passion pour le théâtre comme un exutoire à son introversion, sa recherche désespérée d’un père (émigré au Québec pour y suivre une jolie stagiaire qui l’a détourné de son devoir paternel) et d’une identité réelle, sa quête désespérée de la vérité en mémoire de Johanne et sa culpabilité, elle qui sans le vouloir a joué les rabatteuses pour un psychopathe insatiable. L’image du père absent, tantôt héros, tantôt déserteur ou bien encore indigne, est omniprésente dans ce récit et constitue un lien entre des personnages aussi différents qu’Anne, Johanne et Bernard. Et la chasse au tueur ne pourrait être que prétexte à entreprendre une quête personnelle. Mais peu à peu, les choses ne paraissent plus aussi simples. Car l’une des victimes semble un peu atypique, décalée… La place du père joue un rôle de plus en plus central mais peut-être pas celui que l’on croyait comprendre... L’auteur sait ménager le suspense et, malgré le décalage technologique qui date un peu l’intrigue bloquée en 2000-2001 (chat minimaliste, absence de webcam etc.), on se prend au jeu, on suppute, on cherche à deviner, en vain. Les pistes se multiplient, semblent sans issue… Pour savoir enfin, il faudra lire, jusqu’à la dernière page !
PROLOGUE :
« Avril est un menteur ! Il te promet le printemps, te donne deux ou trois belles journées où tu laisses le parka pour les T-shirts, pi l’maudit t’abandonne sous la neige pour la fin de semaine. Des fois même, tu te réveilles sous un soleil qui brille comme en plein juin et tu t’endors avec le grésil qui cogne aux vitres. J’suis tanné des mois d’avril, ça a pas de bon sens, on devrait passer tout drette de mars à mai ! ».
C’est ainsi que Bernard Pilotte définissait le quatrième mois de l’année et, lorsque je regardais par la fenêtre de ma chambre, je songeais qu’il avait bien raison. La neige tombait sans discontinuer depuis trois jours sur le sud du Québec. De lourds flocons dégringolaient d’un ciel bâché, s’accrochant aux vitres, s’accumulant sur le rebord de la fenêtre jusqu’à tomber en lourds paquets avec un bruit assourdi. Les jours auraient dû s’allonger sensiblement et pourtant, je ne voyais guère d’évolution de l’aube au crépuscule. Le jour et la nuit se confondaient dans la grisaille. Seuls, les gyrophares des chasse-neige coloraient ce paysage monochrome ; depuis longtemps déjà, leurs passages rythmaient mes soirées et mes fins de semaine.
La tête appuyée au double vitrage, je me laissais hypnotiser par les lueurs changeantes qui jouaient sur la surface soyeuse de la neige. Une fois encore, un soleil invisible s’enfonçait dans l’ombre. Mon cœur était triste, comme ce tableau de fin d’hiver. La poudreuse fraîche recouvrait peu à peu la vieille croûte grisâtre de neige compactée qui réapparaissait à chaque redoux. Je me demandais si elle fondrait un jour et si j’arriverais à oublier les événements de ces derniers mois. Des gens avaient croisé la ligne de ma vie comme des pistes de ski coupent une route. Certaines avaient continué leur chemin, d’autres n’étaient jamais réapparues de l’autre côté. Je savais qu’il faudrait plus d’un printemps pour les faire disparaître tout à fait.
Leurs visages s’imposaient à moi. Elles étaient là, sur l’écran de mon ordinateur, souriantes et détendues, presque complices : Johanne, Kathy, Nathalie… Seule Isabelle conservait une attitude un peu hautaine malgré son beau minois et sa chevelure d’Indienne. Je me demandais si le mal la rongeait déjà lorsqu’elle avait pris ce cliché… Elles paraissaient si vivantes que je pouvais croire qu’elles allaient me parler d’un instant à l’autre, mais il n’y avait d’autre bruit dans ma chambre que le ronronnement discret de mon portable et le choc des flocons mouillés sur le carreau, couvert de temps à autre par le signal sonore des déneigeuses en mouvement.
Je fis chauffer de l’eau sur ma plaque électrique et me préparai une soupe chinoise aux nouilles. Depuis plusieurs semaines, c’était mon ordinaire pour souper. Il en existait cinq ou six variétés différentes que j’achetais à la coopérative étudiante de l’université, mais je n’aurais su dire à coup sûr laquelle j’avais mangée la veille : la rouge, l’orange, la verte ? Quelle importance ? Les goûts différaient peu et cette monotonie avait quelque chose de rassurant. Je me raccrochais à mes petites habitudes et ne quittais ma chambre que pour aller en cours ou au laboratoire, et pour faire quelques courses chez le dépanneur. J’évitais la foule et les endroits déserts. Les inconnus me faisaient peur. Je bouclais ma chambre, une chaise bloquant la poignée de la porte. Malgré les antidépresseurs et les anxiolytiques, les cauchemars et les crises d’angoisse me réveillaient trois ou quatre fois par nuit et, lorsque je quittais ma tanière, je vérifiais par réflexe que ni Josée Miousse, ni Bernard Pilotte ne me guettaient dans le couloir. Comment auraient-ils pu m’attendre ? J’étais la seule miraculée de cet effroyable carnage. J’aurais dû mordre la vie à pleines dents, mais j’avalais difficilement un bol de nouilles trop cuites. J’aurais dû faire des projets d’avenir et la plus grande décision de ma soirée avait été de choisir la couleur de mon sachet-repas. Je ne me reconnaissais plus. Je fuyais les miroirs. Ma raison me chuchotait que je n’étais pas coupable mais mon cœur criait que j’étais au moins complice de m’être tue. J’avais beau tenter de me persuader que je souffrais tout simplement du syndrome du rescapé, mes sens, mon corps, mon esprit me refusaient l’espoir. Les souvenirs se mêlaient et se bousculaient, renversés par les bourrasques de l’hiver. Des visages pourtant familiers m’apparaissaient, indistincts. Ma mère, ma sœur Marie, mon père me manquaient. La réalité et le virtuel se mélangeaient, comme les arbres blancs se fondaient dans la neige au-delà de la route.
Je fermai les fichiers graphiques et éteignis mon ordinateur. Une fois encore, je renonçai à détruire définitivement les photos. J’espérais seulement que le printemps, qui se faisait attendre, apaiserait ma douleur. Comme chaque soir, lorsque je me retrouvais seule dans ma chambre, l’histoire me revenait par bribes. Je revoyais la route qui me conduisait de Mirabel à Sherbrooke. C’était l’été, je paraissais insouciante, et je rêvais d’Amériques.
© Lignes Imaginaires 2017/C. Dugave 2003
MAUX D'OU: INCITATION A L'ECRITURE - Christophe DUGAVE : le syndrome de la ligne de crête
Lorsqu’en société j’avoue écrire, on me demande souvent à quel genre littéraire je me voue. Et comme ma réponse est souvent large et imprécise, roman, roman noir, policier, thriller, nouvelles, on m’interroge alors à propos de mon sujet de prédilection. Quel est-il donc ? La réponse est évidente : tout simplement la vie. C’est un chemin sinueux et incertain, le gouffre de part et d’autre, le perpétuel appel du vide et la chute promise au moindre dérapage. Pourtant, la plupart d’entre nous suivons ce sentier sans faire de sortie de route. Mais il suffit d’un rien, d’un petit obstacle sur ce lai pierreux pour que notre existence en soit bouleversée de manière inopinée, profonde et irréversible. Parfois de manière positive, souvent de façon dramatique. Décortiquer chacun des mécanismes qui conduisent de la félicité à l’effondrement puis parfois à la rédemption est sans nul doute l’une des raisons qui me poussent à écrire. J’en vois a priori trois, reposant sur le même concept de destinée ou de hasard (qui ne sont à mon avis que des représentations d’une réalité infiniment complexe) : "l’aile du papillon", "l’instant où tout bascule" et "l’effet domino", processus successifs et interdépendants d’un même phénomène.
L’aile du papillon
Au commencement était un petit rien qui a tout changé dans votre vie. L’évènement fondateur, celui sans qui rien n’était possible et que l’on n’aurait pu prévoir tant le détail semble anodin. Son impact sur notre destin est majeur mais inattendu. La nature exacte du "destin" a fasciné plus d’un écrivain. Notre futur est-il réellement prédéterminé ou bien au contraire dicté au fil de l’eau par tout un ensemble de causes externes, plus ou moins reliées mais néanmoins totalement imprévisibles ? Qui ne s’est jamais demandé pourquoi la chance lui avait souri ou au contraire pour quelle raison le sort s’acharnait-il ainsi ? Comment les évènements qui influent sur notre vie se combinent-ils et comment un infime détail peut-il avoir des conséquences déterminantes sur notre existence ? Comment une option choisie il y a très longtemps, une action d’un tiers que vous ne connaissez pas ou un évènement survenant à des milliers de kilomètres peuvent avoir un effet essentiel sur votre destinée ? A défaut de pouvoir répondre à toutes ces questions que l’on regroupe souvent sous l’interrogation "Pourquoi ?", je m’efforce de proposer quelques éléments de réflexion et, qui sait, de réponse.
L’instant où tout bascule
Rien n’aurait été possible si l’évènement s’était produit à un autre moment. Ou alors, le futur aurait été sans doute très différent. Notre vie n’est en fait qu’une succession d’instants "où tout bascule" mais seulement quelques-uns auront droit de cité dans notre mémoire : ceux qui ont parfois brutalement et toujours durablement changé notre vie. Mais à la prédétermination imposée par la combinaison des causalités s’oppose la notion de choix. Face à une situation difficile ou déterminante, l’être humain a souvent la possibilité d’opter pour l’une ou l’autre des solutions qui s’offrent à lui, voire d’en imaginer de nouvelles. Mais dans quelle mesure ce choix est-il réellement laissé à son libre arbitre et si ce n’est pas le cas, comment les évènements influent-ils sur sa décision ? Et dans ce choix, quelle est la part réelle du hasard ? On peut donc à juste titre se demander "Quand ?" tout cela s’est joué.
L’effet domino : le pire est toujours certain
Reprenant les concepts brièvement développés précédemment, "l’effet domino" vient amplifier le phénomène. Il y a un moment où la situation bascule, entraîne une série de conséquences en cascade de la même façon que, culbutant un peu plus gros que lui, un petit domino de quelques grammes peut finalement jeter à terre une charge de plusieurs tonnes. Le phénomène ne joue pas nécessairement en notre défaveur mais il faut bien avouer qu’il marque notre conscience bien plus durement lorsqu’il mène à la catastrophe que quand il nous propulse vers la gloire ou le Nirvana. Partant du principe de gravité qui veut que l’eau coule toujours du haut vers le bas, la loi de Murphy se vérifie (presque) systématiquement et le pire est à peu près certain. A la notion de temporalité vient s’ajouter une idée de quantité : aussi infime que soit sa contribution, la molécule d’eau en trop, pour infime qu’elle soit, va irrémédiablement provoquer le débordement, la cascade puis le tsunami. Reste à savoir "Comment ?". C’est sans doute en tentant de répondre à cette question au travers de fictions que j’ai le plus de chance de trouver quelques éléments de réponse.
Il me reste aussi à utiliser, avec un peu de finesse si possible, les autres adverbes interrogatifs mis à ma disposition par la langue française. Qui ? Un héros ou une héroïne auquel nous pourrions nous identifier. Quoi ? Des situations que nous sommes susceptibles de connaître. Où ? Principalement en France (mon pays d’origine) et au Canada (où j’ai vécu). Combien ? Généralement un seul héros non récurrent, parfois plusieurs personnages principaux dont les histoires s’entrecroisent. Tout cela pour m’aider à développer quelques thèmes qui me sont chers : le mensonge, la trahison, les secrets de famille, le pardon, leurs effets immédiats ou à plus long terme sur nos vies et notre histoire. Et cette "insoutenable légèreté de l’être" qui nous permet malgré tout d’avancer, envers et contre tout.
"Quelque part vers le Sud" : dystopie très actuelle ou roman apocalyptique prémonitoire ?
Premier roman en parution originale chez LIGNES IMAGINAIRES, "Quelque part vers le Sud" de Christophe Dugave vient de sortir à l’occasion de la rentrée littéraire.
Rédigée sous forme d’un journal intime tenu par une adolescente prénommée Philomène, ce roman décrit la vie difficile d’un village d’Ile-de-France qui doit affronter une série d’hiver rigoureux dans un contexte socio-économique catastrophique et une situation politique plus que confuse dans le milieu des années 2050. Et lorsque Silayne, une jeune musulmane, est recueillie par la famille de Philomène, tout devient beaucoup plus compliqué. En effet, Philomène et les siens ont enfreint les ordres du chef de la milice municipale qui a décidé que tout étranger est un ennemi potentiel. Il faut dire que l’insécurité est la règle à l’extérieur du bourg : les fanatiques de tous bords s’affrontent pour une insaisissable vérité et tentent de conquérir de nouveaux territoires, les petits brigands et bandits de grand chemin agressent les voyageurs et harcèlent les équipes de bucherons qui approvisionnent le village en bois, des chiens sauvages chassent l’homme isolé, les pandémies ravagent des régions entières… Sans compter que Silayne a fui un groupe musulman extrémiste opérant dans la région et que son ancien époux et maître la recherche et pourrait s’en prendre au village qui l’héberge ! Mais fidèles à leurs principes, Philomène et les siens défendent bec et ongles leur protégée. Pourtant lorsqu’Elke, meilleure amie de Philomène, contracte une fièvre hémorragique mortelle peu après l’arrivée de Silayne, le doute s’installe : la jeune fille a-t-elle joué le rôle de porteur sain et si oui, est-ce fortuit ou volontaire ? Car bientôt, une épidémie se déclare et commence à décimer le village tandis que de mystérieux belligérants le prennent pour cible…
On pourrait croire au premier abord qu’il s’agit d’un énième roman de science-fiction retraçant la douloureuse survie de rescapés de la fin du Monde. En effet, le thème (post-)apocalyptique n’est guère nouveau en littérature et a inspiré de nombreux écrivains, de Robert Merle ("Malevil") à Stephen King ("Le fléau") ou James Graham Ballard ("Sécheresse", "Le monde englouti" etc…). La dystopie est également un thème très populaire souvent traité avec une imagination débridée ("Fahrenheit 451" de Ray Bradbury). Elle se confond fréquemment avec le roman post-apocalyptique, soit pour permettre à une nouvelle civilisation d’émerger du chaos ("La planète des singes" de Pierre Boulle), soit pour contrer une lente et irrémédiable désagrégation de la société ("Le meilleur des mondes" de Aldous Huxley). La forme du journal intime est aussi un filon largement exploité, que ce soit dans "Chroniques de la fin du monde" de Susan Beth Pfeffer ou "la déclaration : histoire d’Anna" de Gemma Malley. Mais "Quelque part vers le Sud" se démarque clairement de beaucoup des ouvrages précédents qui expédient l’humanité ad patres avec des cataclysmes spectaculaires aux causes parfois confuses et souvent incroyables. Jouer dans la nuance renforce à la fois la crédibilité du récit et noircit fortement le tableau, anéantissant même l’espoir d’une solution miracle !
"Quelque part vers le Sud" se singularise donc par l’origine multiple de la géhenne qui est en cours alors que l’héroïne rédige son journal intime : surpopulation qui a facilité l’éclosion de pandémies, pollution incontrôlée provoquant un réchauffement climatique qui conduit à un refroidissement paradoxal de l’Europe Occidentale par affaiblissement du Gulf Stream (un scénario scientifiquement envisagé), affaiblissement des états nationaux et fédéraux et montée de l’intolérance et du fanatisme, migration massive des populations, prédominance du chacun pour soi… Plus qu’une apocalypse radicale, il s’agit donc d’une lente et irrémédiable décadence d’un monde qui ressemble furieusement à notre société.
Le réalisme est également accentué par la localisation géographique précise : Bonnelles, un petit village dans le sud de la région parisienne où habite l’auteur qui prête sa propre demeure à l’action et y met peut-être en scène ses (futurs ?) descendants. Contrairement aux autres ouvrages surfant sur la vague de la glaciation massive, l’hiver de "Quelque part vers le Sud" n’est pas plus rigoureux que celui qui sévit de nos jours dans le sud du Canada mais la situation (raréfaction des sources d’énergie et de la nourriture, isolement et insécurité chroniques) le rend intolérable. Tout au long du roman, des thèmes très actuels sont évoqués (la protection de l’environnement et le réchauffement global, l’épuisement des ressources) ou plus largement développés (la valeur de l’amitié, l’intolérance, la solidarité), le tout sur un ton très personnel à la narratrice. Ecrit il y a presque dix ans, le récit prend de curieuses résonnances quand il évoque le fanatisme religieux sous toutes ses formes et le problème des migrants.
Le recours à l’artifice du journal intime n’exclut ni l’action ni les dialogues qui soutiennent le récit. Si l’auteur aborde des thèmes cruciaux et angoissants sans optimisme excessif, il évite aussi de tomber dans le travers du nombrilisme pleurnichard. L’humour n’est donc pas absent lorsqu’il s’agit d’évoquer des problèmes quotidiens plus triviaux et les petits désagréments de cette vie précaire... Quant à l’amour, il n’est pas totalement absent même s’il ne trouve guère sa place dans cette époque troublée marquée par le cloisonnement, le repli sur soi et un cruel et contradictoire manque d’intimité.
Bien sûr, le sujet grave, les personnages attachants et le climat pesant peuvent laisser craindre une fin dramatique. Et en effet, pas de "happy end" sucrée pour ce texte qui assume tout à fait son côté très sombre. Mais cela n’empêche pas une petite lueur d’espoir et d’optimisme d’éclairer malgré tout cette réflexion sur un possible devenir de notre civilisation. Restera au lecteur à s’identifier aux héros et à s’interroger sur la nature profonde de cette fiction : s’agit-il d’une dystopie aux résonances très actuelles ou bien d’un roman apocalyptique aux allures de rêve prémonitoire ? Mieux vaut peut-être ne pas conclure sur ce point.
QUELQUES CITATIONS EXTRAITES DE "QUELQUE PART VERS LE SUD"
…Bien plus que la faim, le froid, la solitude ou tous les dangers qui nous guettent au-dehors, c’est la conscience de notre déchéance qui nous mine et c’est bien contre cela que j’ai décidé de me battre, contre ce sentiment du ridicule dont on dit qu’il ne tue pas. C’est la pire ânerie que j’ai jamais entendue : ici, le ridicule est un assassin et il tue froidement tous les jours !
Nous courrions à notre perte, la fleur au fusil plutôt que dans les champs, inconscients et obstinés, ignorant les coups de semonce d’une Terre mise à mal par la surexploitation des ressources, la pollution chronique et la démographie galopante de populations hors de contrôle. Nous avions minimisé les crises humanitaires, financières et politiques, compensé les pénuries, éradiqué les premières pandémies, forts de notre science et faibles de notre conscience. Nous attendions de pied ferme l’arrivée d’un chaos qui s’était déjà installé. Fanfarons, nous pensions écrire une glorieuse page d’histoire alors que nous ne tracions maladroitement qu’un vague minimum dans un manuel de climatologie que personne ne consulterait jamais.
La tolérance est un luxe aujourd’hui et chacun peu égarer la sienne sans avoir l’impression de perdre l’essentiel.
© Lignes Imaginaires/C. Dugave 2016
Lignes de feu : un sujet chaud, toujours d’actualité
Déjà publié en 2010, ce policier palpitant et complexe se déroule à Sherbrooke, à l’est de Montréal, ville que Christophe Dugave connaît bien puisqu’il y a vécu et déjà situé l’intrigue d’un premier thriller, "Cam@rdage", paru en 2006 aux Editions du Tremplin.
Tout commence par des coups de téléphone anonymes, une querelle entre chercheurs scientifiques, quelques non-dits puis une explosion dans un laboratoire de chimie de l’université de Sherbrooke au Québec dans laquelle un professeur réputé trouve la mort. Bien sûr, la trop évidente imprudence de l’expérimentateur ne résiste pas longtemps à l’examen des faits. Très vite, un enquêteur de la police sherbrookoise et une spécialiste des services d’incendie s’accordent sur la nature criminelle de "l’accident" alors même qu’ils se déchirent dans le quotidien. Cartésienne et mesurée, l’experte a bien du mal à canaliser le bouillant policier qui s’y entend plus en interrogatoires musclés qu’en analyse scientifique de scène d’incendie. Il faut avouer que les suspects sont légion à commencer par les proches de la victime : sa femme qui porte une curieuse brûlure récente à la main, certains étudiants présents ou passés qui pouvaient en vouloir à leur mentor, des collègues inquiets de l’intransigeance et de l’ambition du jeune professeur… Les motifs pouvant expliquer ce crime sont multiples et complexes : jalousie, intérêts industriels et financiers, luttes d’influence et de pouvoir, affaire se sexe. Mais le drame local, survenu quelques jours avant les événements du 11 septembre, prend une toute autre signification après les attentats perpétrés par Al Qaeda en raison des origines syriennes de la victime et des relations conflictuelles qu’elle entretenait avec certains membres de l’université de confession musulmane. Les enquêteurs devront alors composer avec les services secrets canadiens mais aussi avec la jeune épouse du professeur assassiné qui cherche elle aussi la vérité.
Vous l’aurez compris, l’intrigue est dense et complexe, pleine de fausses pistes et de rebondissements, portée par un écheveau de courts chapitres. La coexistence d’antihéros surprend, rend le récit plus réaliste, mais réclame une lecture suivie bien que l’histoire soit portée par un style simple et dynamique. Le parler québécois y est retranscrit jusque dans le rythme du phrasé et ponctué de "sacres" et d’interjections savoureuses. A conseiller donc pour les amateurs de polars, de thrillers et de noir bien noir mais aussi pour les amoureux de la Belle Province. C’est une lecture idéale pour un long voyage ou quelques jours de vacances.
QUELQUES LIGNES EXTRAITES DE "LIGNES DE FEU" :
Nathalie s’étira et observa, encore ensommeillée, le soleil qui jouait dans les rideaux et inondait le plafond de la chambre d’une belle lumière douce et chaude. Depuis une heure déjà, le radioréveil diffusait un fond de musique régulièrement interrompu par un flash météo ou des bulletins d’information sur la circulation. Elle roula sur le côté, à la place qu’avait occupée Djihad. Son parfum imprégnait encore les draps. Il y avait aussi une autre odeur qui planait dans la maison, mais elle ne parvenait pas à l’identifier.
Nathalie sourit et rassembla ses idées. Elle était à présent de bien meilleure humeur. La veille, un nouveau coup de téléphone anonyme était venu perturber leur souper et Djihad avait réglé le problème en débranchant l’appareil, mais Nathalie ne s’était pas satisfaite de cette demi-mesure. Elle lui avait amèrement reproché de ne pas avoir contacté le service clientèle de Bell comme il le lui avait promis, et avait été de mauvaise humeur tout le restant de la soirée. Elle se sentait quand même un peu coupable de ne pas lui avoir fait la surprise comme elle l’avait projeté, mais son exaspération avait pris le pas sur l’excitation. Elle lui annoncerait la grande nouvelle à son retour…
Djihad l’avait assurée qu’il reviendrait en fin de matinée, dès qu’il aurait lancé cette fameuse expérience qui ne pouvait pas attendre. Nathalie n’avait pas bien compris ses explications, mais elle soupçonnait qu’il s’agissait d’une réaction chimique dangereuse qu’il voulait réaliser au calme. Qu’y avait-il donc de si important pour qu’il se remette à manipuler, lui qui était professeur et directeur d’un laboratoire actif et prospère ? Elle ne pouvait s’empêcher d’éprouver de l’inquiétude car, en cas de problème, personne ne serait là pour aider son mari. Elle avait hâte de le voir revenir. Pourtant, elle n’avait pas osé le dissuader d’aller au laboratoire.
Depuis quelque temps, elle sentait Djihad tendu, mal à l’aise, et il avait parfois des réactions brutales qui ne lui ressemblaient pas. Avait-il des problèmes à l’Université ? Ses projets semblaient pourtant avancer et le montage de la start-up prenait forme. Pierre Leroy avait réuni les investisseurs et les négociations allaient bon train : ils pouvaient dès à présent disposer d’un joli capital et la finalisation de l’achat du terrain où s’implanterait Catachimia n’était plus qu’une question de semaines. L’université, la ville de Sherbrooke et le gouvernement provincial apportaient également leurs contributions. Une telle collaboration ne pouvait pas se mettre en place en quelques jours seulement. Mais Djihad était un homme pressé… Etait-ce pour cela qu’il paraissait soucieux, parce que les choses n’allaient pas assez vite ?
Nathalie prit une douche et avala un bol de céréales, des toasts ainsi que du café que Djihad avait laissé au chaud, puis elle prépara un piquenique qu’ils emporteraient au parc du Mont Orford : viande fumée, jambon, œufs durs, salade de maïs et poivrons feraient l’affaire. Il était 9 heures passé lorsqu’elle enfila un T-shirt et un short par-dessus son maillot de bain : c’était sans doute l’une des dernières occasions avant l’hiver de se prélasser au soleil et de se baigner dans les eaux tièdes du lac Stukely. Déjà, les feuillages commençaient à se parer de couleurs merveilleuses ; les matinées fraîchissaient et le soleil se couchait sensiblement plus tôt.
Nathalie ouvrit en grand les doubles rideaux de la chambre à coucher et ce qu’elle découvrit la figea de stupeur. D’où elle était, elle n’apercevait pas les bâtiments de l’université, mais elle ne pouvait ignorer l’épais panache roussâtre qui voilait à présent le soleil. Il y avait un incendie, quelque part sur le campus ou à proximité, aux résidences "Le Montagnais" peut-être. Elle se souvint tout à coup que le mugissement des sirènes l’avait réveillée une heure plus tôt, mais elle n’y avait alors pas prêté attention, encore égarée dans un demi-sommeil. Son cœur se serra et après avoir dévalé les escaliers, elle courut vers le téléphone. Elle ragea en constatant que le combiné était toujours débranché : Djihad l’avait déconnecté la veille, après ce nouvel appel anonyme. Elle le reconnecta et composa hâtivement le numéro : la ligne de son laboratoire était occupée ; sans doute était-il lui-même en communication… Elle se morigéna et se força à reprendre son calme.
A nouveau, elle regarda par la fenêtre et renonça à l’ouvrir car l’odeur de brûlé était de plus en plus présente, même si le vent ne chassait pas la fumée en direction de la ville. On devinait la pulsation des gyrophares bleus et rouges à travers les arbres : la police devait bloquer le boulevard de l’Université. Un moment, elle espéra que c’était une voiture qui avait pris feu mais songea que ce devait être plus grave. Ses mains se mirent à trembler sous le coup de l’émotion et, fébrilement, elle alluma le poste de radio. On y parlait de sport et de politique, mais il n’était nulle part fait mention d’un incendie à l’université de Sherbrooke.
Sans cesser d’écouter les informations, Nathalie rangea le piquenique dans le réfrigérateur et tenta, une nouvelle fois, de joindre Djihad : c’était toujours le même bipbip lancinant… Elle songea soudain que s’il était arrivé quelque chose de grave, les lignes téléphoniques de l’UdS avaient été certainement coupées pour ne pas interférer avec les demandes de secours. L’explication la rassura un peu, mais elle se demanda aussitôt pourquoi Djihad n’avait pas utilisé son téléphone cellulaire. L’appel sur son mobile débouchait obstinément sur sa messagerie. Elle vérifia qu’il ne l’avait pas oublié dans l’entrée et ne le trouva nulle part.
Le téléphone sonna enfin. Elle se rua sur le combiné qu’elle faillit lâcher dans la précipitation. Son "Allo" se perdit dans le brouhaha des annuaires et des pots à crayons renversés.
‒ Nath ? demanda une voix familière.
C’était Raphaël Landry, un des journalistes de "La Tribune", le principal quotidien de l’Estrie pour lequel Nathalie travaillait comme documentaliste.
‒ Ton mari travaille bien au département de chimie de l’UdS ? continua l’homme.
‒ Oui, répondit-elle d’une voix enrouée par l’émotion.
‒ Peux-tu me le passer ? Il y a un gros feu dans un des laboratoires.
‒ Que se passe-t-il exactement ? balbutia Nathalie. Il est parti travailler ce matin…
Son correspondant marqua une hésitation.
‒ Enfin, je ne sais pas… C’était pour lui demander des précisions… Je croyais qu’il était au courant…
Gêné, Raphaël Landry mit rapidement fin à la conversation, non sans avoir cependant tenté de rassurer la jeune femme.
‒ Inquiète-toi pas. C’est normal qu’y donne pas de nouvelles ; toute doit être bloqué avec les secours…
Nathalie raccrocha, tremblante comme une feuille dans la bise et tenta vainement de recouvrer son calme. De retour dans la chambre, elle s’assit sur le lit, et les mains posées à plat sur les cuisses, écouta la radio en fixant le ciel d’un regard implorant.
© Lignes Imaginaires 2016/C. Dugave 2010